-
 Parmi les lecteurs de ce blog, il n’aura échappé à personne que je parle rarement d’essais. Surtout quand ils sont socio-historiques. Mais les plus attentifs de ces mêmes lecteurs n’auront pas davantage laissé de le remarquer : je n’ai pas rompu tous les liens avec la région qui m’a vu naître (pourquoi les romprais-je ?). Et, par ailleurs, j’ai souvent dit le bien que je pensais des écrits de Pierre Kretz, homme de théâtre et romancier (1). Lequel n’a pas digéré la disparition officielle de la région Alsace, fondue récemment dans le Grand-Est, ni le mot malheureux d’un récent président de la République qu’on a vu mieux faire : « L’Alsace n’existe plus ». Kretz nous avait déjà donné, sous ce titre, en 2017, un essai vengeur (2). Il récidive aujourd’hui chez un autre éditeur et sur un autre ton.
Parmi les lecteurs de ce blog, il n’aura échappé à personne que je parle rarement d’essais. Surtout quand ils sont socio-historiques. Mais les plus attentifs de ces mêmes lecteurs n’auront pas davantage laissé de le remarquer : je n’ai pas rompu tous les liens avec la région qui m’a vu naître (pourquoi les romprais-je ?). Et, par ailleurs, j’ai souvent dit le bien que je pensais des écrits de Pierre Kretz, homme de théâtre et romancier (1). Lequel n’a pas digéré la disparition officielle de la région Alsace, fondue récemment dans le Grand-Est, ni le mot malheureux d’un récent président de la République qu’on a vu mieux faire : « L’Alsace n’existe plus ». Kretz nous avait déjà donné, sous ce titre, en 2017, un essai vengeur (2). Il récidive aujourd’hui chez un autre éditeur et sur un autre ton.Du Rhin jusqu’à Nogent-sur-Marne
Seulement, est-ce encore un essai ? On serait plutôt dans le genre du pamphlet. Mais d’un pamphlet qui se jouerait des genres. Je ne m’aventurerai pas sur le terrain même du débat. Pierre Kretz ridiculise avec mordant le centralisme excessif, les hommes politiques versatiles et les universitaires paniqués à l’idée de sembler passéistes — gageons que parmi toutes ces personnes, citées nommément, il ne se fera pas seulement des amis. Pour démontrer l’absurdité d’une « région » s’étendant des bords du Rhin aux confins du bassin parisien, il puise ses arguments dans la géographie et, surtout, dans l’Histoire. Ce qui nous vaut un chapitre, intitulé Histoire d’une fiction, dans lequel il parcourt, brillamment et à bride abattue, les métamorphoses compliquées de la province perdue, depuis les Romains jusqu’au covid. Point culminant : la période 1870-1945, qui voit les Alsaciens changer quatre fois de nationalité et mener deux guerres sous l’uniforme allemand, le plus souvent contre leur gré. Et l’auteur de Vies dérobées (3) de revenir sur la tragédie des malgré-nous, ainsi qu’on les désigne entre Vosges et Rhin, enrôlés de force dans la Wehrmacht, voire dans la SS.
Que penseront de tout ça les « Français de l’intérieur » (« En alsacien ça donne "Inner Frànkrich" »), c’est-à-dire, comme le rappelle malicieusement Kretz, « l’immense majorité de [nos] compatriotes » ? Se sentiront-ils concernés par les drames d’une province plus particulière qu’aucune autre ?... Si on peut présumer que oui, c’est pour les raisons mêmes qui font, me semblent-ils, que le livre de Kretz a bien sa place sur les pages de ce blog.
« Dans l’ombre de tous ces morts »
Pour raconter la « fiction » alsacienne, notre auteur a recours à une autre fiction : son narrateur a été, nous dit-il, longtemps malade ; il souffrait d’« alsacondrie », ce mal dont sont atteints les Alsaciens qui se cramponnent frénétiquement à leur province et refusent les bienfaits modernistes du Grand-Est. Seulement, celui qui parle ici est guéri de ses errances. Et c’est sur un ton navré qu’il les détaille, et avec enthousiasme qu’il chante les vertus de la région nouvelle. Cet usage de l’ironie est la première trouvaille du livre, et on peut regretter que, dans le dernier chapitre, « J’ai replongé », l’auteur tombe le masque et signe de son nom. Mais ce chapitre est court. Tout en savourant le comique pince-sans-rire et la fausse naïveté chers à Kretz (4), le lecteur parcourt la plus grande partie de l’ouvrage avec la sensation d’un étrange et séduisant déséquilibre. Le mélange des tons et des genres vient encore l’accroître. Avec Kretz, l’enfance n’est jamais loin. Elle affleure au détour de presque chaque page, sur le mode de l’humour quand il s’agit des excursions du dimanche dans « la CCIII » paternelle (« Pour les rois, on emploie des chiffres romains, alors que, pour les Peugeot, ce sont des chiffres arabes [mais] tout ceci n’est qu’une question de convention »). Le ton cependant se fait plus grave pour parler des silences qui recouvraient certains pans d’un passé familial malmené par l’Histoire. Et on en vient à cette belle évocation de la ruelle villageoise où le prétendu narrateur a passé son enfance, et sur laquelle pesait « une chose lourde et invisible », « une chose qui était liée aux souvenirs de ceux qui y vivaient et reliée aux fantômes de ceux qui y avaient vécu » — « Nous vivions dans l’ombre mystérieuse de tous ces morts ».
La singularité alsacienne mêle un sentiment de profonde appartenance à une région singulière au vertige identitaire profond qui l’accompagne. Pour la dire, Pierre Kretz invente un essai qui tient de la fiction, une fiction qui tient de l’autobiographie, une écriture bondissante où le rire dit la colère et l’abyssale mélancolie. Une écriture claudicante et nerveuse, à l’image exacte de son sujet. Un morceau de littérature, en somme.
P.A.
(1) Pour en savoir plus sur lui, voir l’entretien qu’il a accordé à ce blog.
(2) L’Alsace n’existe plus, Le Verger, 2017
(3) Le Verger, 2018, voir ici
(4) Voir, par exemple, Quand j’étais petit, j’étais catholique (La Nuée-Bleue, 2005).
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Il est vraiment très étonnant qu’un tel livre soit publié sans la moindre note. Car, enfin, qu’est-ce que le Mouvement de Lapua ? La Lotta Svärd ?... Qui sont Vihtori Kosola, Päavo Nurmi, Tauno Palo ?... Vous le savez peut-être mais moi, je l’avoue, non. Et je doute un peu d’être le seul lecteur français à mal connaître les détails de la très mouvementée histoire de la Finlande entre 1917 et 1947.
Il est vraiment très étonnant qu’un tel livre soit publié sans la moindre note. Car, enfin, qu’est-ce que le Mouvement de Lapua ? La Lotta Svärd ?... Qui sont Vihtori Kosola, Päavo Nurmi, Tauno Palo ?... Vous le savez peut-être mais moi, je l’avoue, non. Et je doute un peu d’être le seul lecteur français à mal connaître les détails de la très mouvementée histoire de la Finlande entre 1917 et 1947.Faisons donc nos propres recherches. Et rappelons que, duché autonome russe, le pays proclame en 1917 son indépendance, pour sombrer aussitôt dans une guerre civile opposant les Rouges aux Blancs, alliés de l’Allemagne, qui se termine par la victoire des seconds et la proclamation de la république. En 1939, l’URSS, tranquillisée par le pacte Molotov-Ribbentrop, lance la Guerre d’hiver, et la gagne. Mais, en 1941, la Finlande se joint à l’Allemagne nazie pour l’opération Barbarossa (c’est la Guerre de continuation). En 1944, cependant, le pays signe un armistice avec Moscou et se retourne contre l’Allemagne (c’est la Guerre de Laponie). Enfin, en 1947, la Finlande retrouve une indépendance placée sous le contrôle distant mais sourcilleux de l’Union soviétique.
Le point de vue de la bécasse
Voilà. Armés de ce très succinct vade-mecum, vous pouvez vous plonger dans les aventures de la Colonelle, qu’on écoute se souvenir, au seuil de la mort, d’une jeunesse passée dans le contexte évoqué ci-dessus. Après la mort de son père, elle tombe, encore toute jeune fille, dans les bras du Colonel, ami de celui-ci et comme lui ex-jäger (1). Sous l’influence de cet amant, plus âgé qu’elle de trente années, elle se détourne du fascisme paternel pour glisser dans une sympathie de plus en plus franche pour les nazis. C’est dans cet état d’esprit qu’elle traverse les conflits que j’ai mentionnés, en observatrice attentive quoique obsédée surtout par sa relation avec son mentor : « La guerre, au total, n’a fait qu’intensifier les sentiments que le Colonel et moi éprouvions l’un pour l’autre »….
Cependant, après la fin des hostilités et, enfin, le mariage, cet amour-passion où le sexe joue un grand rôle tombe d’un coup dans la violence, le guerrier au chômage laissant ses pires tendances s’épancher dans le cadre du foyer conjugal. Ayant réussi, non sans mal, à s’arracher à cet enfer, l’héroïne-narratrice trouve dans un village du Grand Nord la sérénité et un nouveau compagnon avec qui mener une fin de vie paisiblement consacrée à l’écriture. Car, depuis sa prime jeunesse, « inventer », « décrire les lieux et les gens » lui était « aussi facile que de boire un verre d’eau ».
Résumé de cette existence par celle qui l’a vécue : « Papa a fait de moi une fille de la Finlande blanche, le Colonel, une nazie. Je n’ai honte ni de l’un, ni de l’autre ». C’est bien ce qui trouble. Et qui fait la vraie violence du livre de Rosa Liksom, auteure bien connue dans son pays et traduite en de multiples langues, mais peu en français (2). Une des originalités de ce roman étonnant consiste en ceci : raconter l’histoire tragique d’un pays déchiré en adoptant le point de vue d’une bécasse. Et le résultat est d’autant plus frappant que la construction, par juxtaposition de souvenirs présentés comme des anecdotes, imite à la perfection les plus authentiques récits de vie. Une vie, ici, dépourvue de toute culpabilité et dominée par l’étrange fascination éprouvée pour une brute épaisse.
Tout cela confère à ces prétendus souvenirs une tonalité assez ahurissante. En visite d’étude en Pologne occupée, notre amie se lie avec Ilse, son hôtesse, femme d’un officier S.S., laquelle « trouv[e] merveilleux de vivre dans cette nouvelle Grande Germanie où règn[e] une liberté si illimitée qu’elle perm[et] aux Allemands de faire tout ce qu’ils [veulent] ». De retour en Finlande, elle passe de « bons et merveilleux moments, comme cette soirée au sauna avec Himmler ». Les fêtes se succèdent, gibier, alcools, vins fins, et « la bonne odeur propre aux Allemands ». L’essentiel pourtant reste l’amour : quand, pendant la Guerre de Laponie, le Colonel et elle convolent, elle s’écrie sans malice ni nuances : « C’est le plus beau, le plus lumineux et le plus heureux jour de ma vie ».
« Demoiselle Finlande »
Évidemment, la bécasserie de cette bécasse s’explique en grande partie par le fait qu’elle constitue une allégorie de la « Demoiselle Finlande », explicitement désignée ainsi dans le texte, et dont Rosa Liksom, qu’on a parfois qualifiée d’écrivaine « punk », trace ici un de ces portraits volontiers dits au vitriol. Née sous le double patronage d’un père fasciste et d’un oncle « rouge », violée dès l’enfance par un futur nazi, grandie dans la haine des Russes, l’anonyme héroïne avoue tout uniment : « J’aimais l’odeur du cuir et les hommes en uniforme ». Mais elle est aussi possédée par une passion quasi-mystique pour la terre lapone. Et, par cette passion, « Demoiselle Finlande » échappe à la bécasserie intégrale.
« Les pins aux flancs brun-roux bruissaient dans le vent, les sapins barbus de lichen rugissaient, l’écho roulait dans les rochers et un vol de grues craquetait au firmament. Comme saisie de fièvre, j’ai perdu la tête et ri à gorge déployée ». Après cette première extase, vécue en marge d’un camp de la Lotta Svärd (3), les bois, les lacs, les tourbières de l’extrême septentrion formeront un contrepoint permanent à la folie des hommes. Le Colonel partage cette passion avec sa maîtresse, et tous deux, « dans de vieilles forêts de sapins », passent de longs moments à écouter « les chants des perdrix des neiges et des coqs de bruyère ». C’est là que ça devient compliqué. Du coup, encore plus dérangeant. Mais à quoi servirait la vraie littérature, si ce n’est, loin des certitudes pré-formatées et de la morale, à déranger ?...
P.A.
(1) Les jägers étaient des volontaires finlandais, anti-Russes, entraînés en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Ils se fondront ensuite dans la Garde Blanche, puis dans l’armée régulière.
(2) Citons néanmoins Compartiment n° 6, même (remarquable) traductrice, déjà chez Gallimard (2013).
(3) Organisation de volontaires auxiliaires féminines dans l’armée finlandaise pendant la Première Guerre mondiale. Elle sera ensuite associée à la Garde Blanche, elle-même milice anticommuniste constituée pendant la Guerre civile.
 4 commentaires
4 commentaires
-
Elle travaille dans une école de cinéma, mais ses romans (L’Atelier, 2018, Quitter Madrid, 2020, tous deux au Mercure de France) parlent de peinture et de peintres, réels ou imaginaires. Les surfaces, les couleurs, les plis des étoffes n’y voilent qu’à peine la violence du monde, et la pureté de la phrase y contraste avec le caractère charnel et tourmenté de la fiction.
Tout cela, qui m’a frappé à la lecture de son dernier livre (voir ici), me donnait grande envie de poser à Sarah Manigne quelques questions pour ce blog. Elle a aimablement accepté d’y répondre.
Comment en êtes-vous venue à écrire ?
J’ai toujours écrit, mais, pendant longtemps, c’était sous forme de journal intime ou de fragments, dont j’attendais, au fond, qu’ils donnent naissance d’eux-mêmes à quelque chose de plus abouti. Je suis passée à une autre étape assez récemment, quand je me suis aperçue que ça ne viendrait pas tout seul, qu’il fallait travailler et organiser les choses pour qu’elles deviennent un ensemble cohérent.
Cela dit, j’ai toujours trouvé, dans la production audiovisuelle, par exemple, ou le commentaire de documentaires, des métiers qui m’obligeaient à écrire.
Comment écrivez-vous ?
Quand je peux !... Tous mes moments de liberté sont employés à ça, quoiqu’il faille quand même un minimum de temps : une demi-heure par-ci par-là dans la journée, ça ne suffit pas. Mais dès que j’ai ne serait-ce qu’une après-midi… Bien sûr, je tiens aussi en permanence des carnets où je note des idées, des phrases, qui ne serviront peut-être en fin de compte à rien.
Écrire, est-ce pour vous un travail ?
Je ne sais pas si on peut parler vraiment de « travail », dans la mesure où il serait très difficile d’en vivre. Mais, ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit d’une activité qui demande du temps et de l’énergie, comme je disais à l’instant l’avoir découvert. En fait, c’est quelque chose, à mes yeux, qui est assez proche de l’artisanat.
Y a-t-il des auteurs dont vous vous sentez proche ?
Pas au sens où ils constitueraient des modèles et où mes livres essaieraient de ressembler aux leurs. Mais il y a énormément d’auteurs qui m’accompagnent depuis des années et qui me parlent. Ce sont en général des gens qui pratiquent plutôt des formes relativement courtes : Toni Morrison, Erri De Luca, Tabucchi… Oui, il y assez peu d’auteurs français parmi ces écrivains que je relis et auxquels je reviens sans cesse. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que je ne lis pas du tout d’écrivains francophones.
Les auteurs que j’aime sont ceux qui ont une écriture dépouillée, où « il n’y a pas de gras ». À la limite, chez eux, chaque paragraphe, presque chaque phrase sont proches de la perfection.
Parler de peinture, est-ce à vos yeux une autre manière de parler d’écriture ?
C’était le cas dans L’Atelier : je voulais parler de la création en général plutôt que de la peinture, et spécialement de la création littéraire, tout en gardant une distance par rapport à l’écrit, un thème qui est de toute façon difficile à mettre en scène. Il y avait donc clairement une transposition de l’écriture dans le domaine de la peinture.
C’est moins vrai de Quitter Madrid, où tout est né de l’association entre mon désir d’évoquer les attentats [de Madrid, ndlr], et la peinture de Zurbaran, qui me fascine et dont j’avais envie de parler aussi. Ces deux idées se sont nouées sans que je sache très bien moi-même pourquoi. Mais, dans ce roman, la peinture de Zurbaran exprime les émotions de l’héroïne, Alice. Ou plutôt ses sentiments, sa vie intérieure : elle ne retient chez Zurbaran qu’un certain type d’œuvres, qu’on pourrait considérer comme froides, ce qui correspond à sa personnalité, puisque c’est quelqu’un qui se barricade contre ses propres émotions. L’utilisation du thème de la peinture est donc très différent de ce qui se passe dans mon premier roman.
Votre intérêt pour les tableaux et les couleurs se double d’une fascination pour les étoffes… Y a-t-il, pour vous, une profondeur des apparences ?
Je trouve qu’il faut bien attraper les choses par quelque part… Les perceptions, c’est très difficile à faire vivre par les mots, mais c’est à travers elles qu’on peut recréer le réel. Le rapport direct du corps aux choses est, je crois, plus parlant que la parole, parce qu’on est là dans un domaine qui relie l’intérieur à l’extérieur. Et je ne pense pas seulement aux perceptions visuelles : je rêverais de parvenir à décrire des odeurs.
Pour revenir à votre question, l’amour d’Alice pour les étoffes, les vêtements, les parures et l’apparat dans certains tableaux de Zurbaran, ceux, notamment, qui représentent des saintes et où le personnage se détache seul sur un fond uni, correspond chez elle à un goût pour le masque, à un refus de se dévoiler. Elle trouve un certain confort dans la contemplation et l’amour de cette peinture. De façon générale, je crois que ce qu’on aime dans les œuvres d’art, c’est ce qu’elles nous renvoient de nous-mêmes. D’où le rapport changeant qu’on entretient avec les œuvres, qu’on aime ou qu’on aime moins à tel ou tel moment de la vie, en fonction de sa propre évolution. À la fin de Quitter Madrid, si Alice paraît rejeter la peinture de Zurbaran, ou du moins prendre plus de distance par rapport à cette peinture, c’est parce qu’à travers elle c’est elle-même, telle qu’elle était à une certaine époque, qu’elle rejette. Il me semble que le rapport à l’art nous permet ainsi de nous découvrir, de nous connaître, surtout quand il s’agit d’images : la peinture ou la photo s’imposent, sans qu’on comprenne forcément pourquoi d’abord.
Vos héroïnes ont un rapport troublé à leur corps, aux autres, et se tiennent souvent comme en retrait par rapport à la réalité commune. Une certaine forme de décalage définit-elle aussi pour vous la position de l’artiste ou de l’écrivain ?
Je n’avais pas de volonté consciente de faire d’Alice une héroïne qui se tienne à côté du monde. Dans l’ensemble, je ne cherche pas délibérément à « décaler » mes héroïnes. Ce qui est, au fond, un peu inquiétant, parce que ça tendrait à dire que je suis décalée moi-même ! Bref, pour répondre à votre question, si elles sont décalées je dois bien l’être moi aussi, en tant qu’écrivaine.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Pour l’instant, sur rien du tout ! Le confinement, et l’école à la maison avec mes deux filles, m’ont détournée de tout projet littéraire. Car si l’écrivain est peut-être en décalage avec le monde, encore faut-il que le monde soit bien là… En ce qui me concerne, quand je suis coupée de la réalité extérieure comme nous l’avons été pendant cette période, je n’ai aucune inspiration. Quand tout arrive par des écrans, je perds les impressions de tous les jours, qui sont ce qui me donne envie d’écrire. Souvent, si j’écris, c’est pour affronter des choses, dans la réalité quotidienne, que je ne comprends pas et qui m’agressent, que je trouve violentes. En sécurité chez moi, j’étais loin de ces choses…
 2 commentaires
2 commentaires
-
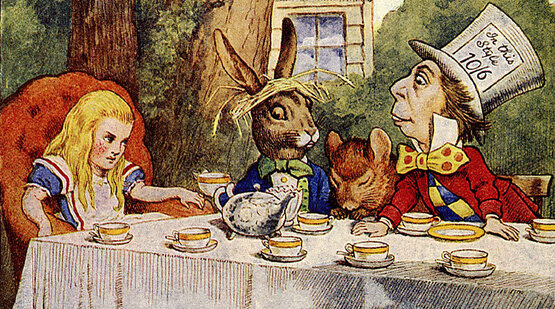 Heurs et malheurs du sous-majordome Minor (Actes Sud, 2017, voir ici) était un roman habile et drôle, placé sous le signe du pastiche et marqué au coin d’une réjouissante absurdité. Dans French exit, le pastiche est peut-être moins visible ; l’absurdité, toujours bien là, est assez appuyée pour neutraliser ce qui pourrait parfois apparaître comme une volonté un peu systématique de faire rire.
Heurs et malheurs du sous-majordome Minor (Actes Sud, 2017, voir ici) était un roman habile et drôle, placé sous le signe du pastiche et marqué au coin d’une réjouissante absurdité. Dans French exit, le pastiche est peut-être moins visible ; l’absurdité, toujours bien là, est assez appuyée pour neutraliser ce qui pourrait parfois apparaître comme une volonté un peu systématique de faire rire.Malcolm a plus de trente ans mais vit avec sa mère, Frances. C’est le cas depuis ses douze ans, âge où il a perdu Franklin, son père, avocat riche et agressif réincarné depuis dans Small Frank, chat de son état. Suzan essaie en vain d’attirer le jeune homme hors d’une relation qui est un curieux mélange de fusion et de distance. Le couple Frances-Malcolm ne travaille évidemment pas, et jette l’argent par les fenêtres au point que, un jour, il n’y en a plus. Privés de leur grand appartement new-yorkais et de tous leurs biens, ils vont se réfugier à Paris, dans le logement (élégant) d’une amie. Là, on voit se succéder les personnages improbables, les repas, les beuveries, les conversations légèrement délirantes, jusqu’à ce que se produise ce qui peut éventuellement justifier le sous-titre : « Une tragédie de mœurs ».
Dickens au pays du nonsense
Formule qui semble d’abord un peu exagérée. Mais il est vrai que le ton, si l’humour foutraque y domine, ne va pas sans certains accents crépusculaires. « Satire de la haute société américaine » et « émouvante virée mère/fils », ajoute la quatrième de couverture. Satire, satire, on peut toujours dire ça, même si le réalisme est si bien battu en brèche qu’on se croirait plutôt dans certaines des gracieuses fantaisies de Woody Allen. Quant à la « virée mère/fils », je ne suis pas sûr qu’elle soit émouvante. Les rapports entre Malcolm et sa génitrice sont d’une singularité insolemment réjouissante, c’est sûr. Cependant rien n’est à proprement parler émouvant, dans ce roman. Certes, tout le monde a eu une enfance catastrophique, tant Malcolm, abandonné tout l’été dans son école déserte (ce qui nous vaut un beau mini-roman dans le roman), que Frances, qui a essayé, en son temps, de mettre le feu à la maison pour attirer enfin l’attention de sa mère. Cependant, tout cela est plutôt de l’ordre de la référence littéraire, et renvoie à celui auquel on pense souvent ici : Dickens.
C’est en effet à un décalque inversé de l’univers du grand romancier britannique qu’on croit plus d’une fois avoir affaire : la pauvreté extrême devient la grande richesse, et le sentiment d’abandon trouve son expression dans le si britannique nonsense, que l’auteur de David Copperfield était du reste loin d’ignorer.
Viande saignante et sandwich au fromage
Les héros de deWitt sont tous restés peu ou prou coincés dans l’enfance, et tout, dans le récit de leurs aventures, tourne au jeu et à la fantaisie loufoque. À commencer par l’écriture, où l’usage du point de vue (quasi) omniscient accroît l’effet des juxtapositions désopilantes : « "Bon, Malcolm, je regrette de casser l'ambiance mais on dirait bien que je suis amoureuse de toi." Il sortit de sa poche un sandwich au fromage qu’il avait secrètement transporté jusque-là et mangea en silence ».
« Je ne suis pas à l’aise quand les choses n’ont plus de sens », déclare un personnage dont on nous avait annoncé : « On remarquait qu’il semblait parfaitement normal, puisqu’il n’avait aucun humour ». C’est dans les portraits que l’art de la formule et le sens du comique absurde se déploient le plus ostensiblement. Exemples : « M. Baker s’apparentait à un rongeur, non pas qu’il se comportât comme tel, mais il ressemblait bel et bien à une souris » ; « [Il] portait un costume de lin blanc mal coupé et usé, respirait avec difficulté, le visage aussi rouge qu’une viande saignante. Il fixait un verre de tequila qu’il tenait à la main ».
Dickens revu par Lewis Carroll. Et un certain désespoir nonchalant traité sur le mode de la dinguerie. Car le nonsense, après tout, c’est l’absence de sens : si les personnages de Patrick deWitt paraissent si légers et flottants, c’est peut-être en raison du vide qui les habite et dont la certitude ne les quitte pas. S’il y a du tragique dans leur histoire, c’est bien dans cette certitude qu’il réside.
P. A.
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Dans sa collection « Fiction et compagnie », le Seuil publie une nouvelle édition des Lettres à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke. La traduction est de Sacha Zilberfarb (après Gustave Roud et bien d’autres). L’originalité est de présenter non seulement les lettres de Rilke, mais aussi celles (sauf la première, perdue) que lui adressait le jeune aspirant écrivain Franz Xaver Kappus. Auquel l’auteur des Sonnets à Orphée prodiguait des conseils tels que celui-ci : « Ce qui se passe au plus intime de vous mérite tout votre amour, c’est à cela que vous devez travailler, de quelque manière, sans perdre trop de temps et de courage à éclaircir votre position à l’égard des gens. Qui vous dit, après tout, que vous devez en avoir une ? »…
Dans sa collection « Fiction et compagnie », le Seuil publie une nouvelle édition des Lettres à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke. La traduction est de Sacha Zilberfarb (après Gustave Roud et bien d’autres). L’originalité est de présenter non seulement les lettres de Rilke, mais aussi celles (sauf la première, perdue) que lui adressait le jeune aspirant écrivain Franz Xaver Kappus. Auquel l’auteur des Sonnets à Orphée prodiguait des conseils tels que celui-ci : « Ce qui se passe au plus intime de vous mérite tout votre amour, c’est à cela que vous devez travailler, de quelque manière, sans perdre trop de temps et de courage à éclaircir votre position à l’égard des gens. Qui vous dit, après tout, que vous devez en avoir une ? »…Le Mercure de France poursuit sa publication du Journal particulier de Paul Léautaud. Après les années
 1933, 1935 et 1936, voici cette année l’année 1937. Rappelons qu’il s’agit des pages retirées du Journal tout court par celle qui le dactylographia, Marie Dormoy. Maîtresse de l’auteur du Petit Ami, elle préférait peut-être ne pas voir divulguer des informations telles que celle-ci : « Les choses agréables pour un homme, elle ne les aime pas et ne s’en cache pas. Elle ne sait pas jouir pour de bon, c’est-à-dire faire jouir rien qu’avec la bouche. Non plus branler vraiment, avec art ». Marie Dormoy a cependant tout conservé et tout transmis, c’est grâce à elle que nous pouvons lire : « Je lui ai fait sortir une jambe, et je me suis mis à lui embrasser le pied — elle a des pieds charmants — à m’amuser à lui sucer les orteils, notamment le gros, lui disant, en riant : "Quel dommage que ce ne soit pas une queue!" ».
1933, 1935 et 1936, voici cette année l’année 1937. Rappelons qu’il s’agit des pages retirées du Journal tout court par celle qui le dactylographia, Marie Dormoy. Maîtresse de l’auteur du Petit Ami, elle préférait peut-être ne pas voir divulguer des informations telles que celle-ci : « Les choses agréables pour un homme, elle ne les aime pas et ne s’en cache pas. Elle ne sait pas jouir pour de bon, c’est-à-dire faire jouir rien qu’avec la bouche. Non plus branler vraiment, avec art ». Marie Dormoy a cependant tout conservé et tout transmis, c’est grâce à elle que nous pouvons lire : « Je lui ai fait sortir une jambe, et je me suis mis à lui embrasser le pied — elle a des pieds charmants — à m’amuser à lui sucer les orteils, notamment le gros, lui disant, en riant : "Quel dommage que ce ne soit pas une queue!" ». La revue Les Moments littéraires (voir ici et ici) consacre une part importante de son numéro 44 à Catherine Safonoff. L’occasion de faire plus ample connaissance avec une œuvre peut-être mal connue du lecteur français, et qui comprend une dizaine de titres, presque tous chez Zoé. « Avant la déferlante » de l’autofiction, cette écrivaine genevoise « a imaginé et commencé à pratiquer une exploration originale de son existence, en jouant avec les formes, en variant les éclairages », nous apprend Daniel Maggetti dans un long texte introductif. « Mon idée, c’est que l’écriture elle-même devient le produit addictif, devient la substitution de la substitution », écrit-elle quant à elle dans Le Mineur et le Canari (Zoé, 2012). « Et la difficulté, c’est que l’écriture est contrainte de signifier quelque chose, elle cherche à remonter à la source d’un poison qui est aussi un remède ».
La revue Les Moments littéraires (voir ici et ici) consacre une part importante de son numéro 44 à Catherine Safonoff. L’occasion de faire plus ample connaissance avec une œuvre peut-être mal connue du lecteur français, et qui comprend une dizaine de titres, presque tous chez Zoé. « Avant la déferlante » de l’autofiction, cette écrivaine genevoise « a imaginé et commencé à pratiquer une exploration originale de son existence, en jouant avec les formes, en variant les éclairages », nous apprend Daniel Maggetti dans un long texte introductif. « Mon idée, c’est que l’écriture elle-même devient le produit addictif, devient la substitution de la substitution », écrit-elle quant à elle dans Le Mineur et le Canari (Zoé, 2012). « Et la difficulté, c’est que l’écriture est contrainte de signifier quelque chose, elle cherche à remonter à la source d’un poison qui est aussi un remède ».P. A.
 votre commentaire
votre commentaire
Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot








