-
 Dans Faux Nègres (Fayard, 2014), Thierry Beinstingel racontait l’enquête menée par deux journalistes dans un village anonyme de la France du Nord-Est, où un parti d’extrême droite qui n’était pas nommé avait réussi son plus beau score. Le récit, mariant curieusement fiction et sociologie, peignait la province dite profonde avec une vigueur qui n’excluait pas la subtilité.
Dans Faux Nègres (Fayard, 2014), Thierry Beinstingel racontait l’enquête menée par deux journalistes dans un village anonyme de la France du Nord-Est, où un parti d’extrême droite qui n’était pas nommé avait réussi son plus beau score. Le récit, mariant curieusement fiction et sociologie, peignait la province dite profonde avec une vigueur qui n’excluait pas la subtilité.On pouvait donc être curieux de voir ce que le même auteur aurait fait de la vie de Rimbaud, à laquelle le titre promettait de mystérieux prolongements. De fait, l’idée de départ ne manque pas d’aplomb ni d’humour : le poète n’est pas mort à Marseille en novembre 1891, on a pris un mort pour un autre, erreur sur les cadavres, on enterre à la place du vrai un faux Rimbaud, l’autre pendant ce temps se rétablit par miracle, un peu de sorcellerie africaine par là-dessus, le tour est joué — parfaitement invraisemblable, mais peu importe.
Que va faire Arthur, une fois ressuscité sous le nom de Nicolas ? Je vous le donne en mille… Disparaître. Le lecteur est prié de suivre sur 400 pages la fugue du faux Nicolas, laquelle réitère celle déjà accomplie par le vrai Rimbaud. À ce stade, qui arrive très tôt, ledit lecteur commence à avoir quelques doutes sur l’intérêt de cette affaire, mais il attend de voir.
Arthur le minuscule
D’abord, « l'ex-poète s'est laissé aller à imaginer son retour en Afrique ». Seulement le risque d'être reconnu est trop grand, sa fuite sera donc une « fuite (…) française ». Et même ardennaise, tant il est vrai qu' « on n'échappe pas à son passé, à son enfance ». Ainsi, Nicolas, à travers, il faut le dire, d'assez beaux paysages, va rejoindre le cadre des premières expériences d'Arthur, renouer (discrètement) avec sa sœur Isabelle étonnée, et même, lors d'un passage à Charleville, aller contempler incognito sa vieille maman, ce qui lui cause l'impression « que son cœur [se déchire] dans sa poitrine comme un tissu trop ancien ». Par ailleurs, il dirige l'exploitation d'une carrière, crée de l'emploi dans la région, se marie, devient père, puis veuf, bref, comme le dit le narrateur lui-même, toute une « petite saga ». Le lecteur se sent soulagé. Ouf, même Rimbaud a sa petite saga, comme tout le monde, car « chaque homme doit trouver sa place, chaque société doit lui laisser sa chance ». En même temps il est un peu déçu, le lecteur. Certes, Thierry Beinstingel s'est « lancé dans une quête inlassable : révéler la poésie de chaque activité humaine », c'est la quatrième de couverture qui le dit. Mais si chaque activité est poétique, pourquoi ne pas avoir fait de l'ex-poète maudit un banquier ou un archevêque ? C'est ça qui aurait eu du panache.
Seulement voilà, l'auteur veut concurrencer Michon, qu'il cite, sur deux plans : combiner à l'histoire d'une vie (devenue) minuscule celle d'une œuvre bientôt mythique. Arthur doit donc rester caché sous l'apparence de Nicolas, et l'histoire, littéraire ou non, suivre son cours en parallèle, en un agréable documentaire ponctué de clichés (Proust auteur de « badineries… de bon goût », Verlaine inévitablement moins grand qu'Arthur, puisqu'il a été élu « prince des poètes », donc reconnu).
Sur trois pattes
Ce n'est cependant pas tout : « les poètes ne meurent jamais », comme le narrateur le répète en refrain, sans doute heureux d'avoir trouvé une formule aussi puissamment originale. Ça lui revient quand même de temps à autre, à Nicolas, le souvenir de l'ancien Arthur. « Il remarque un bosquet au soleil et aussitôt c'est un trou de verdure » ; il passe une nuit avec un amant de rencontre, aussi sec voilà « la circulation des sèves inouïes » qui se déclenche. Là-dessus, la guerre, heureusement, éclate. Celle de 14 — eh oui, le temps passe. Ça s'anime un peu. Peinture détaillée et assez vigoureuse du cataclysme. Nicolas perd tout, famille et possessions, tant mieux : voici venir sa troisième (ou quatrième) vie. Elle consiste à retourner à Harar pour y mourir. Mais comme « les poètes ne meurent jamais », au même moment naît Georges Brassens, cet immense poète du XXe siècle, lequel mettra en musique Jean Richepin, autre géant des lettres, qui a fait le portrait de l'artiste en « oiseau de passage ». Le livre se clôt sur un quatrain tiré de ce texte. Voilà le lecteur soulagé derechef, doublement, d'avoir retrouvé son Arthur tel qu'on lui avait appris à l'imaginer et d'être arrivé au bout de l'histoire.
Parce que, quand même, 400 pages… À balancer entre roman et essai, éloge de la réussite individuelle et révolte, réalisme et grandiloquence pontifiante — mais c'est exprès ! Enfin, sûrement… Nicolas, amputé, se déplace avec des béquilles, si bien que le livre boite, c'est normal. Et, comble de raffinement, la langue aussi. Sérieusement. Phrases bancales (« Il entendit le pas de sa logeuse lui déposer un bol de soupe »), impropriétés (une pupille « cligne », les pensées sont toujours, curieusement, « intérieures »), sans compter les « opportunités » qui sont des occasions, les « options » venant s'ajouter à ce qui est « incontournable », et, je n'invente rien, « le côté obscur de la force »… Tout cela à pleines pages, par pur et simple amour de l'art, c'est courageux. Les correcteurs de la maison Fayard, ayant visiblement bien compris le sens de l'entreprise, se sont gardés d'y rien changer, rendons-leur hommage à eux aussi.
P. A.
Ce texte est paru une première fois le 17 août sur le site du Salon littéraire.
 2 commentaires
2 commentaires
-
 Dans Tristesse de la terre (Actes Sud, 2014), déjà sous-titré « récit », Éric Vuillard montrait en Buffalo Bill, le prétendu héros des guerres indiennes, un des inventeurs de la société du spectacle. C’était assigner à l’écriture une fonction doublement archéologique : remonter aux origines de la modernité et, ce faisant, revenir en les déconstruisant sur ses mythes fondateurs.
Dans Tristesse de la terre (Actes Sud, 2014), déjà sous-titré « récit », Éric Vuillard montrait en Buffalo Bill, le prétendu héros des guerres indiennes, un des inventeurs de la société du spectacle. C’était assigner à l’écriture une fonction doublement archéologique : remonter aux origines de la modernité et, ce faisant, revenir en les déconstruisant sur ses mythes fondateurs.Ces préoccupations se retrouvent dans 14 juillet, ironiquement résumé en son titre. Car c’est bien d’un mythe national et originel qu’il s’agit, et une première manière de le désacraliser consiste ici à partir des prémices de l’événement lui-même : premières émeutes, ouverture des états généraux, discours enflammé d’un inconnu nommé Camille Desmoulins (« C’est inouï le nombre de bègues devenus orateurs, et le nombre de cancres devenus écrivains »).
Les vrais héros du jour de gloire…
Cependant, très vite, le récit de Vuillard en vient à ce qui en constitue le cœur : la fameuse journée. Et ce récit s’inscrit d’emblée contre tous les récits édifiants qui en ont été faits, y compris celui de Michelet, « sublime tour de passe-passe » auquel est rendu en passant un hommage ambigu. Comme les photos d’époque constituaient le matériau de base sur lequel s’édifiait Tristesse de la terre, l’auteur s’est ici plongé dans les témoignages obscurs et les archives de la police. Il y a trouvé, entre autres, des noms propres et des noms de métiers : « Boelher, charron, Bouin, corroyeur, Branchon, dont on ne sait rien du tout, Bravo, menuisier, Buisson, tonnelier, Cassard, tapissier, Delâtre, buraliste »…
« C’est étrange, les noms », commente-t-il, « on dirait qu’on touche quelqu’un ». Et rêver sur ces noms d’hommes, parfois de villages, sur ces professions souvent disparues, c’est arracher aux « mâchoires du temps » les figures oubliées des vrais héros du jour de gloire. Ces héros sont des gens du peuple, c’est-à-dire, avant tout, des pauvres. Le livre d’Éric Vuillard s’efforce de leur rendre toute leur place, ce qui le conduit à une dialectique permanente du collectif et de l’individuel. Le peuple, c’est d’abord la foule, « le très grand nombre muet, masse aphasique ». Cette masse humaine, le texte, dans un style précipité, où les phrases brèves alternent avec les longues accumulations, en restitue les mouvements irraisonnés, les hésitations et les fureurs, comme vues du ciel. Mais à ces plans généraux répondent les images soudain grossies de personnages dont on nous esquisse l’histoire et dans les émotions desquels nous nous insinuons parfois, comme ce Louis Tournay, le premier à sauter dans l’avant-cour de la Bastille : « Qu’est-ce que je fais là ? se dit-il. Il fait quelques pas sur les gravillons. Peut-être que malgré le bruit, il entend crisser la plante de ses pieds sur le sol des rois ».
Comment en vient-on à prendre la Bastille ?
Ces « petits bonshommes de Breughel, ces patineurs que l’on voit de loin depuis l’enfance, ombres familières aperçues au fond d’un tableau, sur la glace » pourraient faire autant de personnages de roman. Et il y a bien des romans possibles dans 14 juillet, lovés dans les plis de l’Histoire, d’où Vuillard les extrait pour nous les montrer un instant avant de les laisser s’effacer (« Et là, ils disparaissent, on les abandonne définitivement, on ne les reverra plus jamais »). C’est en effet en refusant le roman aussi bien que l’histoire comme elle s’écrit d’habitude que se construit ce livre singulier. Son objet n’est ni l’aventure individuelle ni le destin collectif mais le point, difficile à cerner, où l’une s’articule à l’autre : comment en vient-on à prendre la Bastille ? quels gestes minuscules ou décisifs, quels basculements ont-ils dû s’engrener pour produire l’énorme événement ? Se poser ces questions revient à essayer de ressaisir ce qu’il y a, dans la Révolution, de révolte. Et c’est bien, tendresse pour les humbles, haine des puissants, colère, la révolte qui parle par la plume d’Éric Vuillard. Son lyrisme tantôt contenu, tantôt exacerbé en fulgurances brutales, échappe-t-il toujours à la tentation du « morceau de bravoure », à laquelle il critique Michelet d’avoir cédé ? Les mythes sont retors : pour mieux les défaire, on s’y frotte, au risque d’en rebâtir d’autres. L’ambiguïté était déjà présente dans le précédent « récit » de Vuillard, celui-ci ne l’évite pas. Mais tout l’intérêt de son entreprise est justement d’entraîner le lecteur dans l’espace incertain où naissent les grandes concrétions imaginaires. Et de lui faire partager un peu du stimulant inconfort qu’on trouve à s’y aventurer.
P. A.
 votre commentaire
votre commentaire
-
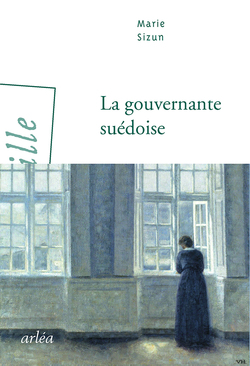 J’ai dit récemment le bien que je pense du dernier roman de Marie Sizun, La Gouvernante suédoise (Arléa). Comme je l’ai indiqué aussi à la fin de mon article, j’animerai, le mardi 13 septembre, dans le cadre des Mardis littéraires de Jean-Lou Guérin, une soirée consacrée à ce livre en présence de son auteure. Celle-ci répondra à mes questions, puis à celles du public, avant de dédicacer son œuvre à qui voudra. Patrice Bouret, comédien, lira des extraits.
J’ai dit récemment le bien que je pense du dernier roman de Marie Sizun, La Gouvernante suédoise (Arléa). Comme je l’ai indiqué aussi à la fin de mon article, j’animerai, le mardi 13 septembre, dans le cadre des Mardis littéraires de Jean-Lou Guérin, une soirée consacrée à ce livre en présence de son auteure. Celle-ci répondra à mes questions, puis à celles du public, avant de dédicacer son œuvre à qui voudra. Patrice Bouret, comédien, lira des extraits.Tout cela aura lieu au Café de la Mairie (1er étage), 8, place Saint-Sulpice, 75006, Paris, à 20 h 30. J’aurai plaisir à vous y rencontrer.
P. A.
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Claudie Hunzinger compose des livres d’herbe, des bibliothèques de cendres et des romans qui ne ressemblent pas à des romans. Si la plasticienne et écrivaine feint de se couler dans le moule du genre dominant, ses récits aux intrigues fugaces ne cessent de s’en échapper pour inventer une écriture singulière qui n’est ni narration ni poème mais tient des deux, et ne parle que de l’essentiel : la présence parmi les êtres et les choses.
Claudie Hunzinger compose des livres d’herbe, des bibliothèques de cendres et des romans qui ne ressemblent pas à des romans. Si la plasticienne et écrivaine feint de se couler dans le moule du genre dominant, ses récits aux intrigues fugaces ne cessent de s’en échapper pour inventer une écriture singulière qui n’est ni narration ni poème mais tient des deux, et ne parle que de l’essentiel : la présence parmi les êtres et les choses.Son ouvrage le plus romanesque est sans doute Elles vivaient d’espoir (Grasset, 2010), où, d’après la correspondance et les cahiers d’Emma, sa mère, elle racontait l’amour qui avait uni celle-ci, avant son mariage avec un Alsacien qui fut membre du parti nazi, à Thérèse, résistante héroïque morte dans les geôles de la Gestapo. Paradoxe. Mais « la vie voudrait toujours ressembler à un roman », affirme la narratrice de ce livre-ci, qui revient aux lettres et autres écrits trouvés dans l’armoire d’Emma pour en tirer ce qui se donne comme le deuxième volet d’une trilogie.
« … dans le roman comme dans un bateau de pêche… »
Car avant Marcel, le mari alsacien resté en 1940 dans sa région d’origine, avant Thérèse, il y a eu, dans la vie d’Emma, Marcelle (« Cela ne s’invente pas. La vie l’avait pourtant inventé »). Coup de foudre adolescent, fascination réciproque. Puis les deux jeunes filles seront séparées, l’une enthousiasmée par la littérature et par ses études de lettres en ces années 1920 puis 1930, l’autre atteinte de tuberculose et contrainte à de longs séjours en altitude.
« J’ai voulu quitter le cycle terrifiant de l’Histoire » écrit celle qui affirme avoir échafaudé le « roman » de « Marcelle, 2 ailes E (…) tel un plan d’évasion ». De fait, on semble d’abord loin des convulsions du siècle, dans ce récit dont l’héroïne s’identifie parfois aux Enfants terribles de Cocteau et qui commence dans une ambiance à la Colette : « village ancien en Côte-d’Or », « de vastes portails, des cours intérieures (…). Des vignes au loin qui tremblaient de chaud. Une école aux volets fermés ». Mais, plutôt qu’à un besoin de diversion, l’auteure-narratrice répond ici à un appel : il s’agit de ramener du passé « ces jeunes filles stoppées net », de « les hisser dans le roman comme dans un bateau de pêche, [de] les convoyer d’un rivage à l’autre ». Ce n’est pas un hasard si le chant de l’Odyssée consacré à la descente d’Ulysse chez les morts est une de leurs lectures de chevet, mentionnée à plusieurs reprises.
« Ordonner l’étoffe d’une vie », donc, « en assembler les parcelles, à bords vifs et sans coutures, comme au laser ». Une activité que Claudie Hunzinger connaît bien. Et qui la ramène, inévitablement, à sa propre vie, à son enfance, au fantôme de ce père ambivalent qui devrait être au cœur du troisième livre qui s’annonce. Si, sans cesse présente dans ce récit où elle réécrit les lettres de Marcelle à Emma, elle parle de son propre travail au passé, c’est que le sujet du livre n’est pas vraiment la vie des deux amies mais la mise en mots de cette vie et les effets qui en ont résulté sur celle de la narratrice.
« Du côté de la vie qui circule »
Quels effets ? L’écriture, chez Claudie Hunzinger, est toujours ce geste qui consiste à se déporter au bord de soi, dans l’espace d’un entre-deux. Celle qui parle ici se sent souvent pareille à Marcelle devant Emma, mais de temps en temps c’est l’inverse. Et dans cette oscillation se dessine le double portrait de deux jeunes femmes que tout oppose : l’une, Emma, s’efforce au contrôle, à la concentration, tente « de toutes ses forces de rejoindre le royaume des adultes » ; l’autre, Marcelle, cherche à « ne pas y entrer » et revendique la « dépossession », la « dispersion » ; l’une est toute verticalité, l’autre se situe « du côté de la vie qui circule » et, comme les couleuvres, qu’elle aime, se coule « horizontalement, dans le monde, les herbes, les eaux, les parfums, les couleurs ». Comment Emma ne serait-elle pas ensorcelée par Marcelle comme par « sa joueuse de flûte », comment ne voudrait-elle pas fuir « cet amour impossible » ?
Le roman raconte, en sept parties, sa fuite. C’est-à-dire peu de chose, à l’aune d’une époque obsédée d’événements. C’est bien un « roman » de Claudie Hunzinger, en fin de compte… D’ailleurs, pouvait-elle ne pas se reconnaître en Marcelle, elle qui se dit d’un pays « où tout est encore lié » ? Avec elle, Novalis n’est jamais bien loin. Les fleurs, dont il est souvent question dans L’Incandescente, « ont beaucoup de personnalité » et « les corolles sont des visages », tandis que le corps d’une jeune fille devient « un iris bleu, très pâle, qui se défroisse lentement ».
Mais ces mystérieuses correspondances horizontales, c’est l’écriture de Claudie Hunzinger qui les fait exister. Et cette écriture qui n’en finit pas de tisser les liens d’une unité secrète entre les choses est, étrangement, toute de ruptures — phrases brèves, courts paragraphes séparés par des blancs, éclats de poésie que viennent déjouer l’humour et les références au très contemporain (Batman surgissant sans complexes au bord des prairies d’asphodèles). Pas d’illusion lyrique, ici, ni de confort de lecture ; mais le déséquilibre toujours retrouvé d’un impossible et essentiel rapport au monde.
P. A.
 votre commentaire
votre commentaire
-
« Ayant pris goût à cette discipline complètement nouvelle pour moi, je sortis bientôt en pédalant du Marché aux pigeons par la Schaumburgerstrasse pour aller sur la Grand-Place et, après deux ou trois circuits autour de l’église paroissiale, pour prendre la décision audacieuse et, comme il allait bientôt apparaître, la décision fatale, d’aller sur le vélo que je maîtrisais déjà, comme je le croyais, d’une façon carrément parfaite, rendre visite à ma tante Fanny qui vivait à trente-six kilomètres de là, près de Salzbourg, dans un jardin planté de fleurs, soigné avec amour, un amour petit-bourgeois, et faisait les dimanches des escalopes panées qui étaient un régal. »
Thomas Bernhard, Un enfant
 votre commentaire
votre commentaire
Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot








