-
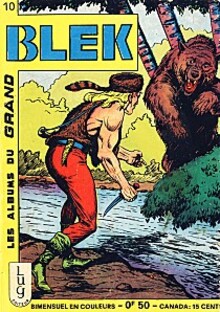 J’ai déjà dit le bien que je pensais du dernier livre de Tanguy Viel, La Disparition de Jim Sullivan . Si je persiste à le trouver d’une astuce assez diabolique dans sa naïveté voulue, c’est sans doute que je n’échappe pas à la fascination pour le « roman américain » que l'auteur de Paris-Brest y décrit et y met en scène. Fascination que, comme beaucoup, j'ai probablement gagnée par l'absorption répétée de films en couleurs à l'époque où les cinémas proposaient encore des entractes avec ouvreuses munies de paniers, et par la lecture de magazines en noir et blanc de petit format qu'on achetait le jeudi au kiosque. Blek le roc, Cassidy et autres Pecos Bill y parcouraient de grands espaces. Quand on atteignait l'adolescence d'autres figures prenaient le relais, bûcherons en chemises à carreaux qui tapaient sur de vieilles machines à écrire en remplissant des cendriers et en vidant des verres de rye. Ces gens-là, ça sautait aux yeux, étaient, quoique écrivains, des espèces d'hommes d'action. Leur écriture elle-même semblait une manière d'acte, brutal, efficace, sans chichis — on était loin de Gide et de Proust.
J’ai déjà dit le bien que je pensais du dernier livre de Tanguy Viel, La Disparition de Jim Sullivan . Si je persiste à le trouver d’une astuce assez diabolique dans sa naïveté voulue, c’est sans doute que je n’échappe pas à la fascination pour le « roman américain » que l'auteur de Paris-Brest y décrit et y met en scène. Fascination que, comme beaucoup, j'ai probablement gagnée par l'absorption répétée de films en couleurs à l'époque où les cinémas proposaient encore des entractes avec ouvreuses munies de paniers, et par la lecture de magazines en noir et blanc de petit format qu'on achetait le jeudi au kiosque. Blek le roc, Cassidy et autres Pecos Bill y parcouraient de grands espaces. Quand on atteignait l'adolescence d'autres figures prenaient le relais, bûcherons en chemises à carreaux qui tapaient sur de vieilles machines à écrire en remplissant des cendriers et en vidant des verres de rye. Ces gens-là, ça sautait aux yeux, étaient, quoique écrivains, des espèces d'hommes d'action. Leur écriture elle-même semblait une manière d'acte, brutal, efficace, sans chichis — on était loin de Gide et de Proust.Le bandeau qui figure sur Sale temps pour les braves, roman de 1964 que 10-18 vient de republier, proclame que Don Carpenter est « le chaînon manquant entre John Fante et Richard Price ». Je ne sais trop que penser de cette histoire de chaînons. Le second auteur, si je comprends bien, est avant tout un scénariste. Quant à celui de Demande à la poussière, on ne voit pas vraiment en quoi il annoncerait Carpenter plus que d'autres. Pourquoi pas le chaînon entre, disons, James Cain et Russel Banks ? Laissons les spécialistes du roman américain en décider… Et contentons-nous de dévorer Sale temps pour les braves en nous demandant de temps à autre pour quelle raison on le dévore avec un pareil appétit.
On suit Jack Levitt, à l'américaine, de sa conception au jour où, quand il a trente ans, sa femme le quitte, et on comprend alors que sa vie est décidément foutue après le bref essai de rédemption qu'avait déclenché sa découverte de l'amour, en prison, avec son compagnon de cellule. Bien sûr il a aussi été boxeur, bûcheron (je vous le disais bien) et a travaillé dans des conserveries. Comme on peut s'en douter il n'a pendant tout ce temps guère fréquenté les salons ni connu beaucoup d'intellectuels à proprement parler. Mais il ne le regrette pas : « Ne comprennent-ils pas », philosophe-t-il un soir de cuite, « que pour certaines personnes, l'opéra, le théâtre, le ballet, c'est la barbe, alors qu'un peep-show sur Market Street, c'est de l'art ? Ils veulent que tout soit chic et gris. Ne comprennent-ils pas combien le bon goût paraît horrible à ceux qui ne le possèdent pas ? Mais ils s'en foutent bien, des gens qui ont mauvais goût ! Mais pas moi. À moi ils me plaisent ».
Entre deux chapitres on s'interroge : d'où vient le plaisir qu'on prend à lire ces histoires de petits délinquants, de bagarres, ces descriptions de parties de billard auxquelles on ne comprend rien et ces dialogues entre vrais durs (« Ben faut croire que tu me tiens par les couilles, alors. — Faut croire ») ? Est-ce l'effet de la fascination (cf plus haut) ou y aurait-il bien là un exemple de la célèbre « efficacité narrative » américaine ? On ne sait pas trop, mais on replonge, et c'est un fait. Jack et ses comparses en rage contre « l'univers tout entier » nous tiennent indéniablement par quelque chose…
Naturellement c'est bien trop long. Ces gens-là ne peuvent rien faire à moins de quatre cents pages. On pourrait ici se passer des cent dernières, qui nous content les déboires conjugaux du héros : Jack n'est vraiment pas fait pour la vie conjugale… Mais la longueur, la volonté de tout dire, l'excès, cela encore fait partie du grandromanaméricain.
Et puis il y a autre chose, qui fait peut-être de Sale temps pour les braves, en fin de compte, un grand roman tout court. Ses personnages, furieux et désespérés de ne pas même être recherchés par la police quand ils disparaissent, tant leur sort laisse tout le monde indifférent, sont en permanence la proie d'une sorte de langueur métaphysique. Désœuvrés, ils courent pourtant sans cesse après une tranquillité qui leur permettrait de réfléchir et de comprendre enfin ce qui leur arrive, et se réveillent « presque tous les jours effrayé[s] à l'idée que le temps soit comme un vent sec qui emporterait [leur] jeunesse et [leur] force ». Leur vie intérieure, dans le tourbillon absurde de leur vie, voilà le vrai sujet du livre, et on se prend à songer à Carco, voire à Genet, quand on lit ces méditations toujours à la limite du monologue intérieur et des analyses omniscientes d'un narrateur sans illusions.
Les interventions de ce montreur de marionnettes, qui soulève quelquefois le rideau sur l'avenir barré de ses créatures, ajoute à ce qu'il faut bien appeler le tragique du roman de Don Carpenter. Et si le titre français choisit malencontreusement de le ramener aux stéréotypes, la version anglaise, Hard Rain Falling, en exprime bien l'amère grandeur.
P. A.
Une première version de ce texte est paru le 14 avril 2013 sur le site du Salon littéraire : link
 2 commentaires
2 commentaires
-
 Michel Longuet est avant tout illustrateur, et le joli livre bleu pâle de moyen format qu’il vient de publier chez Grasset se présente autant comme un carnet de croquis que comme une manière de journal intime.
Michel Longuet est avant tout illustrateur, et le joli livre bleu pâle de moyen format qu’il vient de publier chez Grasset se présente autant comme un carnet de croquis que comme une manière de journal intime.Donc, une fois n’est pas coutume, nous ne parlerions pas littérature ?... Voire. D’abord, parmi ceux dont il est ici question de rechercher et de visiter les anciennes adresses, aux côtés de Méliès, de Gauguin ou de Calder figurent Henri Michaux, Beckett et Jean Follain. Ensuite les dessins de Michel Longuet, minutieux, accumulatifs, animés par le tremblé délicat des images de rêve, transforment les rues et les façades parisiennes en rébus. Les briques, les fenêtres et les ornements y semblent les lettres d’un autre alphabet ; les volumes empilés, comme dans les tableaux de Vieira da Silva, prennent des airs de bibliothèques.
D’ailleurs il y a de l’écrit dans ces dessins : « Matériel forain », « Regina », « Quincaillerie »…, les enseignes ajoutent leurs signes tout à coup mystérieux à ceux que paraissent receler les rues et les places. Les illustrations proprement dites, les annotations manuscrites qui les accompagnent souvent, les petits dessins annexes et souvent très drôles qui les complètent, le texte en tant que tel, se répondent sur la page et s’imbriquent si bien que pour l’auteur-enquêteur on a l’impression que dessiner c’est un peu écrire.
Voilà la troisième raison qui justifie la parution de ces Adresses fantômes dans une collection de « Littérature française ». Au fil des pages s’y dessine aussi un personnage de quasi-fiction, le dessinateur lui-même, étrange détective qui se glisse dans les vieux immeubles en profitant d’une porte entrouverte, son calepin dans la poche et son pliant sous le bras. Sur les traces de Toulouse-Lautrec ou de Marquet il lui arrive toutes sortes d’aventures minuscules : on l’éconduit, on le reçoit, il tombe sur des descendants ; seul dans les pièces vides qu’il dessine, il croit entendre soupirer les fantômes du titre.
Et nous aussi. Car on se laisse prendre à ce fantastique léger qui émane toujours des recoins de la grande ville, passages, rues perdues et anciens ateliers, et que Michel Longuet sait capter avec tant d’acuité discrète. On pense au Paris des surréalistes, à Nadja, au Paysan… Mais c’est le Paris d’aujourd’hui, en perpétuelle voie de disparition. Le petit escalier photographié jadis par Atget et qu’on remet au lendemain de croquer a disparu quand on revient sur des lieux encombrés soudain de palissades. Pour reconnaître les fragments du passé parmi les couches de modernité successives il faut l’œil d’un artiste ; et sa main pour les donner à voir, dans un mélange unique d’humour, de nostalgie et d’élégance.
P. A.
 2 commentaires
2 commentaires
-
 Il est une spécialité littéraire typiquement française et parfaitement respectable : le roman-à-la-Modiano. Je n'en donnerai pas la recette, vous voyez tous ce qu'elle comprend. Seul un des écrivains français les plus singuliers pouvait, à son corps défendant, donner naissance à ce curieux sous-genre: il n'y a là qu'un paradoxe apparent parmi tous ceux qui s'attachent à cette figure indéboulonnable car délibérément insoucieuse de toute mode, etc.
Il est une spécialité littéraire typiquement française et parfaitement respectable : le roman-à-la-Modiano. Je n'en donnerai pas la recette, vous voyez tous ce qu'elle comprend. Seul un des écrivains français les plus singuliers pouvait, à son corps défendant, donner naissance à ce curieux sous-genre: il n'y a là qu'un paradoxe apparent parmi tous ceux qui s'attachent à cette figure indéboulonnable car délibérément insoucieuse de toute mode, etc.Jardin d'hiver, paru à La Table ronde en 2010 et que 10-18 republie ce printemps, s'inscrit à première vue sans hésiter dans la catégorie que je viens de dire. Tout y est : les années 60, la guerre, l'occupation, le spectre de la Shoah, un hôtel presque désaffecté mais pas complètement, des appartements vides où ne reste « qu'un canapé étroit dont le tissu [est] fixé par une rangée de clous formant une arabesque, à la manière de certains meubles des années mille neuf cent quarante ». L'histoire en elle-même (femme disparue, enquête, rencontre avec une autre qui n'est pas la fille de la première mais qui lui ressemble en plus jeune…) n'a aucune importance : on y circule, passant du présent au passé, vécu ou imaginé, et retour, comme dans cet autre appartement, « en étoile, centré autour d'un spacieux vestibule distribuant chaque pièce » et qui, « d'une certaine façon, tourn[e], s'enroul[e] sur lui-même ».
Mais le caractère un tout petit peu appuyé de cette mise en abyme comme la minutie un brin excessive d'autres descriptions de lieux ou d'objets nous avertissent que les choses sont plus compliquées qu'il ne semble. Cette bouteille thermos « gainée d'un revêtement quadrillé » ; ces personnages de retraités qui arborent « pantalon en tergal, casquette, souliers de toile beige à petits trous, blouson havane mariant cuir et maille, comme c'était la mode cette année-là au square » ; ce voyageur de commerce hypocondriaque et sans clients ; ce narrateur auteur de « livres à visée documentaire »…, tout cela est juste assez trop pour indiquer que Thierry Dancourt considère sa propre entreprise avec le degré exact d'ironie requis. Tout ici nous ramène avec discrétion mais fermeté aux procédés de fabrication, et les immeubles de la station balnéaire, nécessairement océanique, inévitablement hivernale, où se passe l'essentiel du roman, ne sont « peut-être pas en pierre, après tout, mais un simple décor de carton-pâte, sans rien derrière ».
S'il n'y avait que cela ce serait déjà quelque chose, au moins une désinvolture réjouissante. Mais il y a plus, et la réussite de Dancourt est, au-delà du second degré ou grâce à lui, d'ouvrir un espace indécidable où le lecteur hésite entre agacement souriant et envoûtement authentique. Car on se laisse attirer, mine de rien, dans ce fantôme d'histoire où on erre en apercevant de temps à autre par une porte entrouverte des perspectives si discrètes qu'on les a peut-être rêvées. Où on croise des personnages eux-mêmes spectraux, comme cette Abigaïl qui remplace une morte et, relevant à peine d'un mal mystérieux, semble encore ou déjà la proie d'une vague stupeur. Le silence paraît « dilater le temps encore davantage », et peu à peu s'installe l'élégante mélancolie des tableaux de Claude Lorrain, dont L'Embarquement de la reine de Saba est accroché en reproduction sur un des murs. Fantastique discret, automne, crachin, Nerval, on est sous le charme malgré soi. Un charme qu'on pourrait appeler poésie.
P. A.
Ce texte est paru une première fois le 16 mars 2013 sur le site du Salon littéraire : link
 votre commentaire
votre commentaire
-
Des Cintres (Minuit, 1993) à Sommes (Argol, 2009), Emmanuel Adely a publié chez différents éditeurs de nombreux livres, la plupart du temps inclassables. Il est aussi l'auteur de pièces radiophoniques, de films, et s'adonne parfois à des lectures-perfomances.
Son écriture, dans un constant rapport de tension et de proximité avec la parole, travaille sur le rythme, le ressassement, la ponctuation ou son absence. Elle dessine ainsi, sans souci de mode et sans discours, la place de l'individu dans sa propre histoire et dans celle que lui inspire le monde ultra-contemporain.
Ayant quitté depuis peu la capitale, Emmanuel Adely n’a pas pu répondre de vive voix à mes questions. Il l’a fait par écrit, et dans sa manière.
Comment en êtes-vous venu à écrire ?
Par méfiance de la parole orale réservée à l'intime - et avec la certitude que cette parole était trop rapide et peut-être -surtout ?- trop instable (comme on le dit d'une solution), l'écriture devenant alors mon médium de communication - je ne sais pas parler pour dire (mais pour autant je ne dis pas en écrivant).
Comment écrivez-vous ?
J'entends j'écoute j'avale (je m'entends je m'écoute je m'avale) jusqu'à ce qu'une phrase s'impose (m'excède me cloue) et me lance. Je note j'écris je rature (des bribes des mots des fureurs). J'écris des carnets de courses de notes, emportés partout, puis sur le clavier ce qui vient (ou pas du tout) de ces notes et fureurs. Tout s'écrit en somme dedans, bout. Puis déborde quand arrive la première phrase c'est-à-dire son rythme.
Écrire, est-ce pour vous un travail ?
Est-ce que ça l'est pour les autres. Je veux dire est-ce que les autre considèrent que c'est un travail. Je veux dire un écrivain n'a pas de situation n'a pas de chômage n'a pas de sécurité sociale alors est-ce que c'est un travail. Je ne sais pas si c'est un travail. Je ne sais pas si c'est un métier. C'est un désir. C'est une douleur. C'est une jouissance absolument de l'ordre sexuel. C'est une précarité. C'est éphémère. C'est désespérant. C'est inutile. C'est isolant. C'est frustrant. C'est suicidaire. C'est injuste. C'est psychotique. C'est une vie. Ce n'est pas un travail.
Y a-t-il des auteurs dont vous vous sentez proche ?
Amicalement, oui, littérairement, moins. Un seul vivant, Guyotat. Non, d'autres. Car des poètes, quelques-uns, parce que c'est vers la poésie (mauvais mot) que la langue s'explore aujourd'hui qu'elle se travaille vraiment, pas dans les romans qui ressemblent à des devoirs de classe. Mais des morts, peu, Bernhard (tout), Reznikoff (tout), Duras (presque), Durrell (Le Quatuor), Genet, et quelques vivants, Butor, Alexievitch, Banks, Ellis, et un Grec exceptionnel et dégueulassement méconnu, Valtinos (tout c'est-à-dire peu).
On a souvent l'impression à vous lire que vous utilisez un matériau en grande partie « autobiographique ». En quoi votre travail est-il différent de celui des auteurs de l’autofiction, courant dans lequel vous dites ne pas vous situer ?
Je n'ai aucune certitude de ma vie. Je ne parle pas que factuellement. Je ne sais pas où elle s'arrête. À moi, aux gens que je connais, aux gens que je connais et qui ne me connaissent pas (Akhénaton, Clovis, De Gaulle, Carla B., Jennifer Lopez…), aux gens qui me connaissent et que je ne connais pas (des fans ?). Je ne sais pas ce qui est vrai. Pour être autobiographique il faut avoir la certitude du réel. Je ne l'ai pas. J'écris ce qui m'est nécessaire. Indispensable. Ce qui me rendrait malade si je ne l'écrivais pas. Me ferait mourir de ne pas l'avoir écrit. (Écrire c'est modifier, donc écrire le vrai n'existe pas, le modifier m'intéresse.)
Dans Genèse (Seuil, 2008), vous vous demandez comment raconter une histoire « qui ne soit pas un récit qui commence à la première phrase et se termine à la dernière phrase, [mais] qui soit une vie, dans une grande tension ». Cette interrogation résume-t-elle votre entreprise ?
Oui.
« Écrire comme on parle » et « lire comme on dit », pour reprendre votre formule, vous permet-il d’atteindre, par-delà les pièges de la « littérature », une certaine vérité de l’individu ?
Écrire comme on parle n'est pas à prendre au pied de la lettre (personne ne parle comme j'écris) (ou oui ?) mais c'est faire bouger la langue (le français quasi langue morte devenue muséale) (un patrimoine) pour la faire vivre. Électrochoc. Au-delà, ce n'est pas la vérité des individus que je cherche à atteindre, mais leurs vérités, leurs contradictions, leurs ambiguïtés, tout ce qui forme ce noeud vivant maladif issu de ça : la vie ne suffit pas.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Un texte inattendu
(absolument inattendu mais qui explore encore la doxa du réel)
Sinon je n'écrirais pas.
 1 commentaire
1 commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot




